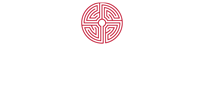Faible densité et innovation ne vont pas naturellement de pair. A priori, ce sont les métropoles et les agglomérations, fortes des ressources nécessaires à l’émergence de nouvelles technologies, qui en bénéficient. Comment faire alors, lorsqu’un territoire ne dispose pas de centres de recherche académique ou d’un tissu d’entreprises disposant de R&D ? Comment mettre en place une organisation et des processus d’innovation au service des habitants et entreprises du territoire ? Le point de vue de CMI sur un enjeu au coeur de l’actualité de ce début d’année.
En 2015, le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires a publié une étude sur l’innovation dans les territoires de faible densité réalisée par CMI, en association avec Claire Planchat de Vous êtes d’ici – Co-agir et Magali Talandier, chercheuse au laboratoire PACTE/Université Joseph Fourrier de Grenoble. Cette étude a pour objectif de démontrer que les territoires de faible densité ont bien une forte capacité à innover et peuvent ainsi répondre aux enjeux d’inégalités territoriales, qui font l’actualité d’aujourd’hui, en tirant parti de leurs spécificités. A travers les quinze études de cas réalisées partout en France, dix leviers d’innovation ont été proposés. A l’heure, où des appels à projet comme Action Cœur de Ville ou encore Territoire d’industrie ont été lancés par la puissance publique, revenons sur les ressorts qui pour nous doivent favoriser l’innovation dans les territoires.
Une définition de l’innovation qui ouvre des perspectives nouvelles aux territoires à faible densité
Une redéfinition de la notion de faible densité
L’étude a proposé une cartographie des territoires à faible densité du point de vue de l’innovation. A l’échelle des intercommunalités, elle observait l’intensité des facteurs de l’innovation proposés par l’OCDE :
- Présence de classe créative et concentration de talents,
- Présence de la recherche académique et privée,
- Maillage du territoire par des réseaux de communication et de transports,
- Taille du marché et de la demande,
- Accès à un réseau de compétences et partenaires,
- Accès au financement et au foncier à vocation économique.
Ce travail de cartographie a permis de classer les 2127 intercommunalités en fonction de leur capacité d’innovation théorique. Le premier décile des intercommunalités les mieux dotés concentrent 80% des emplois en conception et recherche, on considère ainsi que les déciles de 2 à 10 représentent les « territoires à faible densité ». Cette cartographie, qui recoupe fortement la cartographie démographique, montre que 86% du territoire national accueillant 41% de la population n’auraient pas la capacité théorique suffisante pour innover.
Un enjeu des politiques publiques pour réduire les inégalités territoriales
C’est pourtant un enjeu national de réduction des inégalités territoriales que d’embarquer ces territoires dans une dynamique d’innovation (dont une définition plus large que la seule innovation technologique permet de prendre davantage en compte les utilisateurs, les fournisseurs, les pouvoirs publics et les associations) avec le déploiement du numérique qui permet à ces territoires d’être hyperconnectés et insérés dans des réseaux d’innovateurs. Tout l’enjeu réside dans la capacité du territoire et notamment des acteurs publics à animer un réseau d’acteurs pour faire émerger l’innovation et la transformer en valeur pour les habitants.
« Territoire pépite », « Territoire laboratoire » ou « Territoire coopératif » ou comment tirer des caractéristiques spécifiques de ces territoires
L’étude démontre qu’être un territoire à la faible densité peut tout à fait être regardé comme un atout pour innover au sein d’un espace où les acteurs se connaissent bien et sont en capacité à se mobiliser rapidement. A l’image de la start-up, les territoires de faible densité sont souvent plus agiles que les grandes métropoles qui peuvent parfois connaître des formes d’inerties. L’analyse détaillée des 15 études de cas a permis de faire ressortir trois grands types de territoires innovants à faible densité.
Le « territoire pépite »
Fondé sur un modèle de développement endogène, le territoire pépite tire parti de ses ressources locales : patrimoine architectural, environnement de qualité, compétences et savoir-faire singuliers ou encore présence d’une industrie de premier plan. Après avoir identifié les atouts différenciants de leur territoire, les acteurs de cet écosystème sont en capacité à formaliser une stratégie de valorisation des ressources internes dont ils disposent. Savoir détecter les « pépites » de son territoire devient alors un enjeu clé ! En Lorraine, le village de Vannes-le-Châtel (600 habitants) a développé, sous l’impulsion de son maire, le projet CERFAV (Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers) qui est un bon exemple de valorisation d’un savoir-faire ancestral dans les métiers du verre. Le centre développe des formations, assure une veille scientifique et technique et contribue au transfert de technologies et expertises dans ce secteur.
Le « territoire laboratoire »
La faible densité est appréhendée ici non plus comme une contrainte à l’innovation mais un de ces ressorts principaux. Le territoire se transforme en laboratoire pour tester en mode agile des solutions innovantes répondant à des usages de vie (mobilité partagée, gestion des ressources, habitat dispersé, maintien à domicile…). La capacité à proposer des espaces de démonstration et les expertises associées devient la clé du développement ! Il est en effet parfois plus facile de tester des solutions innovantes à une petite échelle, plutôt que dans un environnement complexe comme peut l’être celui des métropoles. C’est souvent un bon moyen pour construire des coopérations durables avec les acteurs métropolitains proches. Dans la communauté de communes de Surgères en Charente-Maritime, la création d’un moulin pilote dans le cadre du projet Agripolis a permis au territoire d’acquérir une visibilité vis-à-vis des industriels céréaliers.
Le « territoire coopératif »
A l’inverse du territoire pépite, Le modèle de « territoire coopératif » repose sur une stratégie de développement exogène. Le territoire déploie une stratégie de coopération avec d’autres territoires ou acteurs qui doivent lui permettre d’accéder à des ressources lui permettant d’innover : coopération avec des espaces métropolitains, des grands industriels ou autres partenaires (universités, laboratoires, chercheurs, entrepreneurs…). La coopération entre territoires de faible densité, peut prendre la forme de retours d’expérience ou d’échanges d’expertise et de méthodologies. Le projet LEADER Seine Aval, dans les départements des Yvelines a suivi cette logique de coopération en tirant parti des complémentarités entre ville et campagne. Une offre de logements étudiants à la ferme a ainsi été mise en place. Celle-ci répond à l’enjeu de tension de l’offre de logements étudiants en ville et d’autre part à un enjeu de soutien et de diversification des sources de revenus des agriculteurs.